
Propos recueillis par Jean-Louis Gouraud. – Les Archives de La Revue pour l’Intelligence du Monde. Cette interview a été publiée dans le numéro 85 qui est sorti en septembre 2019-
Dans l’univers composite des sciences humaines, pourtant riche en fortes personnalités, François Pouillon occupe une place à part. Tant à cause de l’originalité de ses travaux qu’à cause de la singularité du lieu où il professe. Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), il y propose conférences et séminaires, regroupés sous la mystérieuse dénomination de « parcours anthropologiques dans le monde arabe ».
En quoi cela consiste-t-il exactement ? En une succession de points de vue éclairés où se mêlent ethnologie, littérature, arts, archéologie et orientalisme.
Cet éclectisme provient sans doute du fait que l’animateur de ces mille et une journées d’études n’est pas un ethnologue au sens strict – je veux dire étroit – du terme : de formation, François Pouillon est philosophe.
Et, même s’il s’en défend, le fait d’avoir eu pour père un architecte certes contesté, mais indiscutablement novateur et talentueux, n’a pas été sans lui donner un goût prononcé pour les beaux-arts et pour la création.
La spécificité de François Pouillon ne réside pas seulement dans la diversité de ses approches, toujours bienveillantes mais jamais complaisantes, toujours respectueuses mais, Dieu merci, toujours teintées d’humour. Elle est aussi dans sa façon courageuse de s’interroger sur l’utilité de sa propre discipline et de mettre en doute, parfois, la qualité des travaux dont elle accouche. Ce sont les mêmes vertus, que certains de ses collègues considèrent bien sûr comme de graves défauts, que l’on retrouve dans le nouveau volume de son Anthropologie des petites choses 1, qui, à peine paru, lui vaut déjà éloges et réprimandes.
Pour répondre aux questions de La Revue, François Pouillon a dû surmonter ce que certains pourraient prendre pour de la timidité, alors qu’il ne s’agit que de modestie et de pudeur. l J.-L. G

La Revue : Vous êtes directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Une vénérable institution puisque Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss et autres célébrités y ont professé, mais un peu mystérieuse. À quoi et à qui sert cette école ? Et vous, qu’y enseignez-vous ?
François Pouillon : Quand j’ai mis pour la première fois le pied dans cet établissement, cela s’appelait encore l’École pratique des hautes études. C’était un conglomérat de spécialités bizarroïdes, avec de grands savants que l’on avait bien du mal à caser dans l’organigramme des universités, où les « disciplines » étaient organisées autour de ces concours classiques que sont l’agrégation et la thèse d’État. Il s’agissait de spécialités très pointues, où la connaissance se transmettait de manière ésotérique, dans le cadre quasiment religieux de « séminaires » : de maître à disciple. Je crois c’est Marcel Mauss qui disait : « Un étudiant, c’est de la spécialisation ; deux étudiants, c’est de la vulgarisation. »
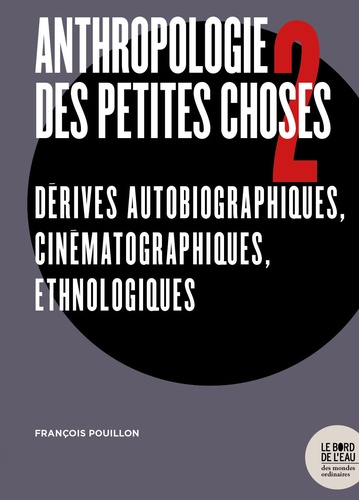
C’est dans cet environnement qu’ont été mises en place les structures de l’institution, qui se sont largement maintenues depuis : faible charge d’enseignement, autonomie de recrutement, liberté de recherche offrant un potentiel d’innovation considérable. Telle était l’École pratique.
Les choses ont bien changé quand Fernand Braudel, l’un des grands de l’histoire contemporaine, s’avisa que cette institution d’érudition marginale pouvait être un outil pour imposer un renouveau des études historiques, impulsé par ce que l’on a appelé l’École des annales (du nom de la revue fondée par Marc Bloch et Lucien Febvre). Il s’agissait de sortir d’une histoire classique, « événementielle », celle aussi des grands récits nationaux à la Michelet. Cela passait par la mise à contribution d’autres sciences sociales : économie et anthropologie surtout, mais aussi géographie, biologie, démographie, esthétique, droit, etc. Les gens qui émargeaient alors à cette « école » étaient chichement rétribués mais faisaient là ce qu’ils voulaient, c’est-à-dire du neuf.
Il s’est alors passé quelque chose que l’on a souvent vu dans l’histoire des sciences : cette petite école, passant de la marge au centre, a fini par occuper un territoire considérable.
Devenue trop grande, la VIe section de l’École pratique a pris son autonomie pour devenir l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), qui, délaissant l’enseignement d’initiation, se limite à l’encadrement de thèses de doctorat.
La notoriété internationale conférée par quelques figures majeures – Barthes, Berque, Bourdieu, Lévi-Strauss, Le Roy Ladurie, pour ne retenir que des gens finalement recrutés, après Braudel, au Collège de France – et d’autres formidables subalternes a fait de cette institution un lieu où il faisait bon vivre la recherche, avec, en prime, la consécration.
En ce qui me concerne, j’ai été élu pour parler des sociétés pastorales nomades dans le monde arabe, les fameux Bédouins, et autour. Mon travail s’inscrivait autant dans l’histoire que dans l’anthropologie. Il ne se limitait pas aux matériaux ethnographiques recueillis sur le terrain, mais fouillait dans la littérature de voyage, la peinture « orientaliste », ce qui croisait les discussions sur l’orientalisme à propos de quoi j’ai eu le plaisir de diriger un dictionnaire. 1
Comment en êtes-vous venu à étudier le monde arabe ? Par atavisme ? On sait que votre père, l’illustre architecte Fernand Pouillon, a fait une grande partie de sa carrière en Algérie.
Je répondrai clairement que non, même s’il existe une pièce à conviction assez compromettante : un petit film d’actualité de Pathé-Journal, disponible aujourd’hui sur YouTube, où l’on voit, au moment de l’inauguration, par le maire d’Alger, de grands ensembles sur la haute ville, le 1er août 1954, un petit bonhomme déguisé en spahi qui présente sur un coussin les ciseaux qui vont servir à couper le ruban cérémoniel. Le petit bonhomme en question, c’est moi ! Peu avant le déclenchement de l’insurrection algérienne, j’ai bien passé des vacances à la villa des Arcades, résidence de mon père sur les hauts d’Alger. Je me souviens même avoir librement déambulé dans la casbah d’Alger avec ma mère. Cela dit, ce fut une simple parenthèse estivale. Et je ne suis plus retourné ensuite en Algérie avant l’automne 1988, alors que je pensais pouvoir le faire sans l’interposition de mon père, lui-même mort en 1986. C’était une illusion, mais cela, je l’ai constaté plus tard. Si je n’ai jamais eu honte d’être le fils de mon père, je n’ai jamais accepté de me considérer comme un héritier. Et c’est pour avoir senti son ombre peser lourd sur moi chez mes interlocuteurs algériens que j’ai refusé par la suite toute invitation qui me fut faite d’aller en Algérie.
Bon, alors, si ce n’est pas par atavisme, c’est par goût de l’exotisme ?
C’est sans doute en rupture avec l’orientation de mes parents, tous deux passés par l’École des beaux-arts, que j’ai tourné le dos à une « vocation artistique », et que je me suis orienté vers une activité de réflexion. Tout jeune, je pensais à Sciences-Po, mais j’ai finalement opté, en arrivant à l’université, pour la philosophie. C’est ce cursus que j’ai suivi à la Sorbonne jusqu’au diplôme d’études supérieures, préparé avec Suzanne Bachelard, sur une question d’épistémologie historique : « La philosophie de la science chez Kant » (1967). Vous voyez : ça me plaçait assez loin du monde arabe !
De fait, marxiste que j’étais alors (comme 97 % de mes condisciples – statistique approximative), je pensais que la métaphysique pure était un jeu abstrait parfaitement stérile. Je ne voulais pas non plus en rester à l’histoire des idées, comme la pratiquait mon maître Alexis Philonenko [1932-2018], celle des systèmes philosophiques qui s’engendraient d’âge en âge les uns les autres. Je sentais la nécessité d’avoir un rapport pratique avec les choses.
Pour les gens de mon âge et de ma disposition d’esprit, à cette époque, il y avait deux portes de sortie. Elles avaient pour noms Lacan ou Lévi-Strauss – autrement dit la psychanalyse ou l’anthropologie. J’ai choisi sans hésiter l’anthropologie, et un camarade de lycée qui m’avait précédé sur ce chemin, Marc Le Pape, m’a introduit chez Georges Balandier : l’anti-Lévi-Strauss, mais un homme qui faisait rentrer l’histoire, la modernité, le politique – tout ce que j’aimais – dans ses perspectives anthropologiques.
Normalement, j’aurais dû partir en Afrique noire, où Balandier avait ses entrées. Mais, jeune marié, je fus contraint d’accepter un poste de professeur de philosophie, le premier disponible, dans les ex-colonies. Ce fut la Tunisie, où je débarquai sans préparation aucune. Je conserve une immense gratitude envers mes élèves, qui m’apprirent alors sur le tas l’islam et l’arabité, en même temps que je leur enseignais, à partir de Descartes, de Rousseau et de Marx, des choses qu’ils comprenaient fort bien. Tombé là par hasard, j’allais m’y fixer : le hasard et la nécessité, en quelque sorte.
Ces premières années furent pour moi une propédeutique à l’islam, avec voyages et excursions, nombre de lectures et apprentissage (tardif) de la langue arabe – version dialectale, ce qui fut une erreur. J’aillais bientôt faire mon trou, si j’ose dire (il y avait là des troglodytes), dans une région du pays pour engager un travail de terrain : l’Extrême-Sud. Par goût de l’exotisme ? Sans doute, mais aussi parce que ça n’intéressait pas les universitaires du pays, tous obsédés par l’idée bourguibienne de la modernisation. Je me fixai là aussi parce que, au fond, ça me rappelait mon pays : né dans le Midi, j’avais passé toute ma jeunesse à vadrouiller dans les collines autour d’Aix-en-Provence. Ce pays calcaire profondément érodé, âprement desséché, me rappelait étrangement les contreforts de la Sainte-Victoire que j’avais quittés à 18 ans pour « monter » à Paris.
Dépaysement quand même, parce que le principe de l’enquête anthropologique consistait alors à séjourner durablement chez les autres, ce que, timide que j’étais, je n’aurais jamais fait sans une impérieuse obligation professionnelle. J’ai rencontré là des gens formidables, parce que ce pays retenait encore ses élites et que l’on croisait ainsi de vrais intellectuels qui, pour être parfois de simples paysans analphabètes (ou lettrés seulement en arabe), comprenaient souvent avec intelligence ce que je faisais, voulurent bien m’aider à y avancer.
Le Sud tunisien fut donc votre première expérience « scientifique », le premier de ce que les ethnologues appellent le « terrain ». Et ensuite ?
J’étais alors enfermé dans la perspective monographique : l’idée de cerner un groupe compact, une « tribu » ou une « communauté », cette fiction ruraliste qui pesait alors sur l’approche des campagnes tant françaises qu’exotiques. J’en ai été guéri par la pratique méthodique des « histoires de vie » avec les indigènes, qui me fit voir qu’aucun de mes informateurs n’avait passé toute sa vie au village. Ces gens avaient, bien sûr, une forte attache locale et ils se retournaient vers le lignage, le « pays » (on disait el-watan, autrement dit « la patrie ») pour les choses importantes de la vie : les parents qu’on y avait encore, le mariage, les investissements fonciers, la vieillesse bien sûr et, si possible, la mort. Mais pour le reste, il fallait appliquer une géographie beaucoup plus vaste : les déplacements d’hiver vers les pâturages ou d’été vers les riches terres du Nord, les migrations vers la Libye, vers les villes et, si possible, vers la France. J’aurais pu me contenter d’étudier cela, quitte à me soucier un peu de dynamique régionale, et c’est ce que firent en effet nombre de mes collègues, ceux qui interviennent dans les colloques avec la phrase légendaire : « In my village… » Mais les occasions, les hasards de la vie m’ont amené à aller voir ailleurs. Le basculement est venu en 1978 d’une double rupture : avec ma femme d’alors, qui introduisit quelques désordres dans ma vie, et avec le régime « modéré » de Bourguiba, qui se révéla, cette année-là, particulièrement brutal dans la répression d’un mouvement syndical de caractère, on peut dire, insurrectionnel. C’est dans ce contexte que je me portai vers d’autres expériences exotiques. La première, inespérée, fut d’être embringué, en 1979, dans une grande enquête sur les Bédouins d’Arabie saoudite 2. Une autre expérience me conduisit chez les Peuls du nord du Sénégal.
J’y
restai quand même sur des recherches de terrain avec des
agropasteurs. De ces expériences qui me conduisirent jusqu’à la
fin des années 1980, je conserve un souvenir inoubliable. J’ai pu
en tirer tout le parti dans le cadre d’un séminaire sur le thème
« An-
thropologie du pastoralisme nomade » animé à
l’EHESS avec mon ami Gianni Albergoni.
Mais on vieillit, n’est-ce pas ? On fatigue un peu à crapahuter ainsi dans les déserts. Et après une vingtaine d’années à faire ce type d’enquêtes (j’ai encore fait des excursions aventureuses dans le nord du Soudan en 2006 et je me suis dit alors très fort que ce n’était plus de mon âge…), j’ai adopté un autre rapport au « terrain ». Il s’agissait alors de travailler sur les questions de représentation du social, de ce social que j’avais sillonné pendant vingt ans, mais cette fois à travers d’autres types de documents : la littérature de voyage, la peinture, la photographie, choses merveilleuses par elles-mêmes.
Comme j’aime quand même échanger avec des vivants, je me suis trouvé en parallèle un autre type d’indigènes : universitaires, peintres, collectionneurs, agents culturels de tous ordres, quidams intéressés par les thèmes sur lesquels j’enquêtais, notamment cette question éminemment anachronique aux yeux de tant de gens : le cheval ! Cela dit, le jour où, par une magnifique après-midi de printemps, j’ai fait un entretien à Alger, en sirotant une bière dans les jardins de l’hôtel Saint-George, avec un ancien directeur de l’École des beaux-arts, je me suis dit que j’étais passé dans un nouveau registre de l’enquête…
Mais, bref : le tout est de rester lucide et de se dire que, pendant que l’on se goberge à deviser ainsi, il y a de vraies gens, dans les djebels, qui continuent à se coltiner la vraie réalité.
Vous avez publié récemment des textes assez provocateurs sur votre discipline, l’anthropologie : un collectif Littérature et ethnographie 3, où vous affirmez que les écrivains font souvent une meilleure ethnologie que les ethnologues eux-mêmes ; un autre, collection de notices sur des sujets les plus divers, Anthropologie des petites choses, dont le second volume vient de paraître 4. Tout cela a provoqué quelques remous dans la profession ?
Je suis content de vous voir associer ces ouvrages. Ce sont des variations que j’ai aimé lancer contre l’anthropologie académique, celle qui pense que l’on avance en entassant des données dans des fichiers, dénombrant dans des termes assez abstraits les instances et les articulations du social. Cela a fait en partie le succès de la discipline, car, dans ce monde, on aime bien les gros mots. Mais nombre de professionnels se sont souciés d’en dire un peu plus sur l’autre partie de la recherche, à savoir l’enquête, qui se passe rarement dans les conditions d’une expérimentation en blouse blanche.
C’est à ce point que la littérature est instructive. Elle intervient ici comme discipline pirate qui n’évacue pas, comme c’est le plus souvent le cas avec l’ethnologie académique, les conditions laborieuses dans lesquelles s’est déroulée l’enquête. En outre, elle offre souvent, ce qui n’est pas rien, une qualité d’écriture que, reconnaissons-le, les professionnels de l’ethnologie ne se croient pas toujours tenus d’offrir !
Mais tout ça, c’est de la cuisine interne à la discipline, où s’opposent des « écoles » structurées sur diverses bases. Cela remonte aux années 1968, où tout le monde était marxiste, mais où l’on s’opposait entre « staliniens » et « gauchistes ». Il faudra un jour faire l’histoire de cela. L’enjeu est autre quand il s’agit de s’adresser à un public plus large. Mes volumes d’Anthropologie des petites choses sont des collections d’essais qui veulent réfléchir, à partir d’expériences personnelles (terrains et dépaysements divers), sur les rencontres exotiques quand, rentrant à la maison, nos manières de faire nous apparaissent à leur tour étranges. J’y revendique la liberté d’associer des souvenirs, des réflexions, des affirmations intempestives sur nos manières de faire, qui ne sont pas moins sauvages que celles des indigènes. J’aime bien cette réflexion de l’ethnologue Marc Augé qui dit que, si l’on veut faire l’expérience de la sauvagerie et de l’altérité, il n’est pas besoin de se faire payer une mission en Papouasie : il suffit de participer à un conseil de copropriété de votre immeuble. C’est là que l’on trouve de vrais réducteurs de tête.
1. Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, éd. Karthala, 2008 (réédition augmentée en 2012).
2. Bédouins d’Arabie. Structures anthropologiques et mutations contemporaines, Paris, Karthala, 2017.
3. Terrains d’écrivains. Littérature et ethnographie (avec Alban Bensa), Toulouse, éditions Anacharsis, 2012.
4. Anthropologie des petites choses. Dérives autobiographiques, cinématographiques, ethnologiques (volume 2), Bordeaux, éditions Le Bord de l’eau, 2019.
#François Pouillon, #indigènes


– Pour vous abonner à La Revue pour l’Intelligence du Monde : https://www.laboutiquejeuneafrique.com/common/categories/153


Soyez le premier à commenter