
Cet article a été publié dans le numéro n°86 de La Revue pour l’Intelligence du Monde. (novembre-décembre 2019). Il est signé Olivier Marbot.
Lorsqu’il décide, en octobre de cette année-là, de se lancer à l’assaut de Moscou, Hitler se pense encore invincible. Si le Royaume-Uni lui a résisté, l’Europe est à genoux et la Russie s’effondre. C’est pourtant à Moscou – et non à Stalingrad comme on l’a dit souvent – que sa chance va tourner.

C’est le 23 juin 1941, au lendemain du lancement de l’offensive contre l’Union soviétique, que Hitler vient pour la première fois visiter sa Wolfsschantze, sa « tanière du loup ». Ce quartier général destiné à mener la guerre sur le front de l’Est a été bâti au cœur d’une épaisse forêt à Rastenburg, en Prusse-Orientale (aujourd’hui Gierloz, en Pologne). Il est constitué d’un ensemble de blockhaus et de maisons en rondins dont les toits sont recouverts d’herbe, afin de les rendre plus difficilement repérables par les avions ennemis. Le tout est entouré de barbelés et desservi par un aérodrome, et le Führer, accompagné de sa cour, arpente le site d’un air satisfait.

Au début de l’offensive, les principales unités de l’armée allemande avaient atteint un point situé à seulement 20 miles du centre de la capitale soviétique. Elles furent stoppées par l’épuisement des troupes et la survenue d’un froid polaire.
Un officier subalterne, pourtant, confie discrètement son étonnement à l’un de ses supérieurs : la Wolfsschantze lui semble petite et peu confortable. Le général le toise, puis s’esclaffe : à quoi bon construire un vaste complexe ? La conquête de l’URSS – baptisée opération Barbarossa – s’annonce déjà comme un succès ! Les Soviets ont été pris par surprise, leur aviation a été décimée avant même de pouvoir décoller, et les Panzer de Guderian avancent vers l’est à une vitesse terrifiante sans rencontrer de résistance. D’autant que l’Armée rouge a été complètement désorganisée par les purges de Staline. Moscou va tomber en moins de cent vingt jours, conclut l’officier. Nous serons rentrés chez nous à Noël.
C’est également l’avis de Hitler, qui a un plan bien établi. Son groupe d’armées Nord (Heeresgruppe Nord) va fondre sur Leningrad (Saint-Petersbourg), tandis que le groupe Sud (Heeresgruppe Süd) s’emparera de l’Ukraine et de ses vastes réserves agricoles et minières. Ne restera plus qu’à cueillir Moscou qui tombera d’elle-même. Ensuite, on repoussera les Soviétiques jusqu’à l’Oural, limite naturelle entre l’Europe et l’Asie, et les territoires conquis seront repeuplés par des Allemands, puis, au besoin, par d’autres Européens « racialement purs ». Pour le chef nazi, « il est inconcevable qu’un peuple supérieur soit condamné à vivre sur un sol trop étroit pour lui quand des masses amorphes qui n’apportent rien à la civilisation occupent de vastes étendues de l’une des terres les plus riches du monde ».
Les Asiatiques seront donc repoussés vers l’est, et un état de « guerre permanente » prévaudra à la frontière, ce qui évitera aux colons aryens de sombrer dans la mollesse. Les agriculteurs allemands feront prospérer les fertiles plaines ukrainiennes, les chalutiers aryens puiseront dans la mer Noire de quoi nourrir le Reich tout entier. Dans vingt ans, prédit le Führer, les Européens en quête d’une vie meilleure n’émigreront plus vers l’Amérique, mais iront s’installer dans ce nouvel eldorado oriental.
Dans un mois, il dormira au Kremlin
Durant tout l’été, les prédictions du chef nazi semblent se réaliser. Comme à l’ouest, la tactique du Blitzkrieg fonctionne parfaitement, et les troupes s’enfoncent toujours plus loin en Russie. La Wehrmacht encercle Minsk et passe le Dniepr en juillet, prend Smolensk en août. Bientôt, les armées Nord sont aux portes de Leningrad, celle du Sud est en vue des faubourgs de Kiev. Quant à l’armée du Centre, elle fonce vers Moscou, mais la capitale est encore loin et la résistance de l’Armée rouge se montre de plus en plus acharnée, se soldant par des pertes terribles. En septembre, l’état-major allemand fait face à un dilemme : le groupe Centre (Heeresgruppe Mitte) peut pousser tout droit vers Moscou, mais cela créerait alors un saillant dans la ligne de front qui le rendrait potentiellement vulnérable.

Hitler résout le problème : Moscou n’est pas, à ses yeux, un objectif stratégique prioritaire. La cible principale est Kiev et la maîtrise totale de l’Ukraine et de ses ressources naturelles. Il envoie donc les blindés de « Schneller Heinz* » Guderian vers le sud, avec pour mission d’épauler le général von Rundstedt dans sa conquête de Kiev et du Donbass. Heinz le Rapide accomplit sa tâche avec l’efficacité qu’on lui connaît : le 19 septembre, l’Armée rouge doit se résoudre à fuir Kiev.
L’essentiel est fait, estime Hitler. Reste à confirmer cette nouvelle victoire par la prise, éminemment symbolique, de la capitale de la Russie communiste : Moscou. Confiant, il imagine déjà ses troupes défiler au pas de l’oie sur la place Rouge. Dans un mois tout au plus, il dormira au Kremlin.
L’indispensable Guderian est rappelé, et, le 30 septembre, l’Allemagne lance officiellement l’opération Typhon, dont le but est la prise de Moscou. Mais tandis que ses Panzer foncent rejoindre les armées du Centre, commandées par Fedor von Bock, Heinz Guderian s’inquiète. Même si les succès s’accumulent, la résistance des Russes est loin d’être négligeable. Leurs batteries antiaériennes, notamment, font des ravages dans les rangs de la Luftwaffe. Dont les pilotes soulignent aussi les qualités du chasseur russe Yakovlev Yak-7, qui leur donne bien du fil à retordre et se permet même de suivre les Juncker Ju 87 Stucka quand ceux-ci attaquent en piqué. Sur terre, Guderian a aussi été confronté au tout nouveau char T-34, bien supérieur à ses Panzer IV. Le seul moyen de les neutraliser, écrit-il, est de réussir à se placer derrière eux et à tirer directement sur la grille qui protège leur moteur.
Mais c’est avant tout le calendrier qui effraie Schneller Heinz et beaucoup d’autres officiers généraux. L’offensive sur l’Ukraine a coûté beaucoup de temps. Trop sans doute. L’automne approche et va transformer les routes russes, non pavées, en rivières de boue collante. Le phénomène a même un nom : « raspoutitsa. » Puis viendra l’hiver, et, depuis Napoléon, tous les officiers de toutes les armées d’Europe savent qu’il est à peu près impossible de faire la guerre en Russie en hiver. Les chefs de corps demandent que leur soient livrés des uniformes chauds et de l’antigel pour les véhicules. Mais plus le front s’étire, plus la logistique devient compliquée et les requêtes restent lettre morte.
Staline aussi sait que le temps joue pour lui et que la saison froide sera son allié. Mais il faut tenir jusque-là, et, au rythme où les Allemands progressent, ils seront à Moscou avant les premières neiges. Le 6 octobre, il rappelle celui qu’il considère comme son meilleur commandant en chef : Gueorgui Joukov. L’officier de 45 ans a été remarqué par le « petit père des peuples » en 1939, lorsqu’il était à la tête des troupes russes en Mongolie. Staline apprécie son génie tactique, mais aussi sa capacité à sacrifier ses hommes sans état d’âme si cela lui paraît nécessaire. Envoyé à Leningrad, où la situation semblait désespérée, Joukov a tenu, et la ville n’est pas tombée. Mais on parle, déjà, de plus de 600 000 civils morts de faim, et le siège n’est pas terminé.
Prendra la ville en tenailles
Sitôt arrivé à Moscou, le général fait le point des forces en présence. Côté nazi, on compte environ 1 million d’hommes. Les Soviétiques en ont un peu plus à leur disposition, sans doute 1,2 million, mais seulement 90 000 pouvant être directement engagés dans la défense de Moscou. Côté blindés et artillerie, l’avantage est clairement allemand : 1 700 chars contre 1000, 14 000 canons contre 7 600. L’aviation russe, enfin, est supérieure en nombre, car les Allemands ont perdu beaucoup d’appareils depuis le début de Barbarossa. Mais la Luftwaffe, même affaiblie, reste d’une redoutable efficacité.

Josef Staline (à g.) et le général Georgi Konstantinovitch Joukov.
Penché sur les cartes, Joukov comprend alors le plan des Allemands, qui consiste à prendre la ville en tenailles, en s’emparant des deux bastions que sont les villes de Viazma et de Briansk. Et puisque les troupes soviétiques sont pour l’instant éparpillées un peu partout sur le front, il est décidé de les réorganiser en trois lignes. La plus éloignée ira des villes de Rjev à celles de Viazma et de Briansk, la deuxième – la « ligne Mojaïsk », à 60 km de la capitale – s’étendra de Kalinine à Kalouga. Enfin, Moscou elle-même doit devenir une forteresse, et ce sont les civils qui vont s’en charger : femmes ou adolescents, tous les non-combattants sont réquisitionnés pour creuser, à la pioche, des fossés antichars ou élever des barricades. Et parce que l’avance rapide des Allemands ne lui donne pas assez de temps pour s’organiser, Joukov décide de les retarder en envoyant à leur rencontre les jeunes cadets de l’Académie militaire de Podolsk, une ville située au sud de la capitale. Inexpérimentés, les étudiants sont massacrés et, racontent quelques-uns des rares survivants, la bataille est d’autant plus acharnée qu’ils n’ont guère le choix : sur leurs arrières, des hommes du NKVD tirent sur tous ceux qui feraient mine de reculer. Une pratique qui deviendra courante durant le reste de la guerre.
La presse nazie crie au triomphe
L’offensive allemande, pourtant, se poursuit avec une redoutable efficacité. Orel tombe le 3 octobre, Briansk le 6, Viazma le 10. Dans cette dernière ville, considérée comme un point clé pour la prise de Moscou, les tueries sont particulièrement épouvantables. Les survivants évoquent une rivière rouge de sang, disent avoir dû marcher sur les cadavres pour fuir. De son côté, la Wehrmacht assure avoir déjà fait 400 000 morts et 600 000 prisonniers depuis le lancement de l’opération Typhon. Des chiffres sans doute exagérés, mais tout de même assez proches de la réalité.
À Berlin, la presse nazie crie au triomphe, annonce l’effondrement de l’URSS pour les jours à venir. Sur le terrain, les officiers sont plus mesurés. Tout se passe comme prévu, certes, mais le ravitaillement en vivres et en matériel est de plus en plus chaotique. Il faut rationner canons et mortiers, et bien sûr les uniformes d’hiver ne sont toujours pas là alors que les premières neiges ont commencé à tomber le 7 octobre. Il faudrait 30 trains chaque jour pour alimenter les troupes, on n’arrive à en acheminer que 20. Quant aux Russes, ils contre-attaquent avec vigueur, notamment autour de Briansk. L’avancée allemande s’en trouve retardée, et les pertes s’accumulent, même si elles restent inférieures à celles de l’ennemi : trois soldats russes tombés pour un allemand, pendant toute la guerre dans l’Est, selon les historiens.
Le 13 octobre, les Panzer atteignent la ligne Mojaïsk, dernier rempart soviétique avant Moscou.
Dans la capitale, où les raids aériens sont quotidiens, la panique gagne. Molotov, le chef de la diplomatie russe, invite les ambassadeurs et les journalistes étrangers à partir et leur propose de monter dans des trains à destination de Kuibyshev, une ville située sur la Volga, quelques centaines de kilomètres plus à l’est, où Staline a ordonné d’évacuer une partie des membres du gouvernement et de la direction du Parti. Le 16 octobre, la capitale a déjà perdu presque 1 million d’habitants par rapport au mois de juin, et les rues sont embouteillées de véhicules de toutes sortes cherchant à fuir. Les scènes de pillage et d’agressions se multiplient. Les autorités ordonnent que toutes les installations qui ne peuvent être déplacées soient minées afin que l’on puisse les détruire avant l’arrivée des Allemands.
Une épaisse fumée noire s’échappe du tristement célèbre immeuble de la Loubianka, où le NKVD a entrepris de brûler ses documents les plus compromettants. Dans les appartements, certains Moscovites se débarrassent en hâte des portraits de Staline et des œuvres complètes de Lénine qui trônent dans leur bibliothèque, craignant des représailles de la part des futurs occupants nazis. La rumeur selon laquelle les chefs du Parti et des komsomols ont fui vers l’est enfle et provoque la colère. « On nous disait que nous étions le pays le plus riche du monde alors que nous crevions de faim, et maintenant où est Staline ? Il nous a abandonnés ! » hurlent les plus désespérés.
Contrer l’ogre français
Staline pourtant est toujours au Kremlin. Mais il s’interroge. Faut-il tenir Moscou à tout prix ou sauver ce qui peut encore l’être et laisser les Allemands s’engluer dans la neige et la glace avant de lancer la contre-attaque depuis l’Est ? Moscou, pense-t-il, n’est pas un site aussi facile à défendre que Leningrad. Alors que faire ? Un train spécial l’attend à la gare, et trois avions sont en permanence prêts à décoller, il n’a qu’un mot à dire. Selon la rumeur, les premières troupes allemandes seraient à 10 km à peine.
Le 16 au matin, circulant en voiture dans la capitale, il aperçoit des Moscovites chargés de lourds fardeaux, apparemment désireux de quitter la ville, et va à leur rencontre. Les civils l’interrogent : « Camarade Staline, quand allons-nous stopper l’ennemi ? » « Il y a un temps pour tout », répond-il sobrement avant de remonter dans son véhicule. Arrivé au Kremlin, il ordonne l’évacuation de tout le Politburo et convoque Beria, le chef du NKVD : c’est lui qui devra coordonner la résistance et les sabotages dans Moscou une fois que les Allemands l’auront prise. La décision du chef de l’Union soviétique est arrêtée : il quittera la ville le lendemain.
Cependant Staline hésite encore. Le 17 au soir, il se plonge dans les Mémoires de Mikhaïl Illarionovitch Golenichtchev-Koutouzov, le glorieux chef des armées du tsar vainqueur de Napoléon en 1812. Jusqu’à la dernière minute, y lit-il, personne ne savait ce que Koutouzov allait faire pour contrer l’ogre français.
Le 18 au matin, Staline se rend à la gare de Kazan, où l’attend son train spécial. Mais au lieu d’embarquer, il arpente le quai, tout à ses pensées… puis fait demi-tour et remonte en voiture. Sa décision est prise : Moscou ne tombera pas.
Dès lors, tous les moyens nécessaires vont être mis à la disposition de Joukov pour stopper enfin la progression des troupes nazies. La loi martiale est décrétée le 19 octobre. Ordre est donné au NKVD de tirer à vue sur tous les traîtres, déserteurs, propagateurs de rumeurs et espions supposés. Beaucoup d’innocents y laisseront la vie, mais le message est clair, et toute la population de Moscou en est consciente : Staline reste, nous allons nous battre et nous vaincrons.
Les Japonais n’attaqueront pas
À Londres et à Washington, dont les ambassadeurs ont tenu à ne pas quitter Moscou, l’évolution de la situation est suivie avec un mélange d’espoir et d’angoisse. Les États-Unis ne sont certes pas en guerre, mais ils soutiennent ouvertement l’Union soviétique et le Royaume-Uni, et leurs vaisseaux de guerre qui escortent des convois de ravitaillement destinés aux alliés sont régulièrement attaqués, parfois coulés, par les U-boot allemands. Roosevelt veut entrer dans le conflit, mais son opinion publique est trop divisée et il ne peut pas forcer la main au Congrès, seul autorisé à déclarer une guerre.
Quant à Churchill, il sait que, si Moscou tombe, les Japonais profiteront immédiatement de l’occasion pour attaquer les Russes par l’est, en Sibérie. L’URSS tombera, et le Royaume-Uni se retrouvera de nouveau seul face aux puissances de l’Axe.
L’unique espoir vient de ce fameux espion communiste d’origine allemande, Richard Sorge, qui envoie régulièrement depuis Tokyo des rapports détaillés sur les intentions de l’état-major japonais (lire La Revue no 84). À Moscou, on le presse de découvrir si les Japonais envisagent plutôt d’attaquer par le nord (en Sibérie) ou par le sud (vers les possessions britanniques dans le Pacifique). Sorge se démène, aiguillonne ses agents, cherche à savoir si les régiments impériaux se font livrer des uniformes d’été ou d’hiver. Londres aussi aimerait savoir : si c’est le sud, les Britanniques se retrouveront avec une guerre à mener sur deux fronts. Si c’est le nord, l’allié russe risque de s’effondrer. Voire – le soupçon reste vivace au sein d’une partie des diplomates anglais et américains – de nouer une nouvelle alliance avec Hitler afin de sauver ce qui peut l’être. Sombres perspectives, dans tous les cas. Autour de Churchill, ses ministres le pressent d’insister auprès de Roosevelt pour que les États-Unis entrent enfin en guerre. Fataliste, le Premier ministre les invite à la patience et répète qu’il a confiance en son ami le président américain.
La bonne nouvelle survient quelques jours plus tard. À Tokyo, Sorge se dit maintenant convaincu que les Japonais n’attaqueront pas la Sibérie. La saison est trop avancée, les généraux nippons craignent l’hiver russe et préfèrent temporiser. Aussitôt, Staline ordonne de rapatrier dans l’Ouest une partie importante des troupes positionnées en Orient. Entre octobre 1941 et janvier 1942, 400 000 de ces « Sibériens** » parfaitement équipés et entraînés au combat hivernal rejoignent le front ouest, dont 250 000 directement envoyés à Moscou. Joukov respire. D’autant que les températures continuent de chuter.
Quant à Staline, sachant combien la politique est affaire de symboles, il décide d’organiser le 7 novembre, comme chaque année, une grande parade militaire sur la place Rouge pour célébrer l’anniversaire de la révolution. Il informe aussi ses conseillers qu’il prononcera un discours important qui devra être radiodiffusé dans tout le pays. Effrayés, certains lui rappellent que l’aviation allemande bombarde la ville chaque jour. Staline ordonne de renforcer les défenses et insiste : le risque est grand, mais si l’opération réussit les gains seront plus grands encore.
Malgré le gel et la neige, le défilé est un succès. S’exprimant depuis le mausolée de Lénine, le chef suprême reconnaît que la situation est difficile et que les nazis ont conquis des parties importantes du territoire soviétique. Puis rappelle que Napoléon lui-même s’était cassé les dents sur la Russie, ajoute que Hitler a déjà perdu 4,5 millions d’hommes depuis le lancement de Barbarossa – ce qui est complètement faux – et conclut : « Les Allemands jettent leurs dernières forces dans la bataille alors que nous disposons de réserves humaines inépuisables. Ils veulent une guerre d’extermination… eh bien, ils l’auront. »
Les troupes allemandes, pourtant, continuent de progresser. Mais l’hiver se fait impitoyable. Hommes et chevaux meurent de froid par milliers tandis que le lubrifiant gèle dans les armes et dans les véhicules. Guderian s’épuise à demander des uniformes d’hiver qui n’arrivent pas tandis que le général von Kleist, dont les troupes se heurtent aux « Sibériens », est épouvanté par leur « résistance fanatique ». Les températures tombent à – 40 °C.
Un raid surprise
Le 29 novembre, Staline convoque Joukov et le somme de lui dire « franchement » si Moscou va tenir. Le général le promet, affirme que l’ennemi est épuisé et n’a plus aucune réserve. Le 6 décembre, pour la première fois, les Russes lancent une contre-offensive.
Mais c’est le lendemain, 7 décembre 1941, que la guerre bascule vraiment. Au petit matin, le monde apprend qu’il s’est produit quelque chose de grave dans le Pacifique. Les heures passent, l’information se précise : le Japon a attaqué. Qui ? Les Américains, croit-on savoir. Churchill appelle Roosevelt, qui confirme : la flotte du Pacifique a été en bonne partie détruite lors d’un raid surprise de l’aviation japonaise. « Maintenant, nous sommes dans le même bateau », conclut le président américain avant d’aller présenter au Congrès – qui l’adopte à la quasi-unanimité – un projet de déclaration de guerre. Churchill n’en montre rien, mais intérieurement il jubile. Cette fois, la guerre est gagnée.
Le 8 décembre, admettant finalement qu’il sera impossible de prendre Moscou tant que l’hiver durera, Hitler autorise ses généraux à camper sur leurs positions et à ne mener que des actions défensives. Trop tard, estime Guderian, qui écrit à sa femme : « Nous avons grossièrement sous-estimé la taille de ce pays, la rudesse du climat et la détermination de l’ennemi, et nous en payons le prix. » Certains régiments reculent afin de regagner des zones fortifiées et plus faciles à défendre, mais le Führer éructe : interdiction de céder un pouce de terrain. Les généraux expliquent : les positions actuelles sont intenables, le sol est gelé, on ne peut pas creuser pour créer des abris ou des tranchées. « Faites des cratères avec les mortiers, s’agace Hitler. C’est ce que nous faisions dans les Flandres pendant la Première Guerre. » Les officiers baissent la tête et maugréent : l’hiver flamand n’est pas comparable à l’hiver russe et ils ont besoin de toutes leurs munitions pour se battre…
Furieux, Hitler relève de leur commandement von Bock, von Brauchitsch (chef de l’Oberkommando des Heeres, l’état-major de l’armée de terre) et Guderian, et se nomme lui-même à la tête de toutes les armées. « La tâche du commandant en chef, explique-t-il, est de mener les troupes selon les préceptes du national-socialisme, et je ne vois aucun général qui ferait cela comme je veux que cela soit fait. » À Rome, où il est ambassadeur, Otto Christian Archibald von Bismarck, le petit-fils de l’ancien chancelier, est atterré : « Nous sommes entrés dans le Ve acte de la tragédie, assure-t-il à ses hôtes italiens embarrassés. Le monde entier va voir à quel point Hitler est fou. »
Les combats autour de Moscou dureront jusqu’au début de l’année 1942, mais les Allemands n’entreront jamais dans la capitale russe, et l’opération Typhon se soldera par un échec indiscutable. La bataille aura fait 2,5 millions de morts, dont 2 millions de Russes. Mais elle aura asséné un coup fatal au mythe de l’invincibilité de l’armée allemande. Au début de 1942 et en l’espace d’une année, le rapport des forces aura été complètement inversé. Hitler et ses alliés italiens et japonais, dorénavant, sont en guerre contre le monde entier.
Olivier Marbot
* Heinz le Rapide, le surnom gagné par Guderian à la suite du succès de sa guerre éclair.
** « Sibériens », entre guillemets, car les divisions dites sibériennes n’étaient pas seulement constituées d’habitants de -l’Extrême-Orient russe. Dans son livre, Andrew Nagorski cite, par exemple, le lieutenant Vladimir Edelman, un juif ukrainien qui avait combattu à Kiev et dont la famille avait été décimée par les Einzatsgruppen nazis lors du célèbre massacre de Babi Yar, à la fin de septembre 1941.
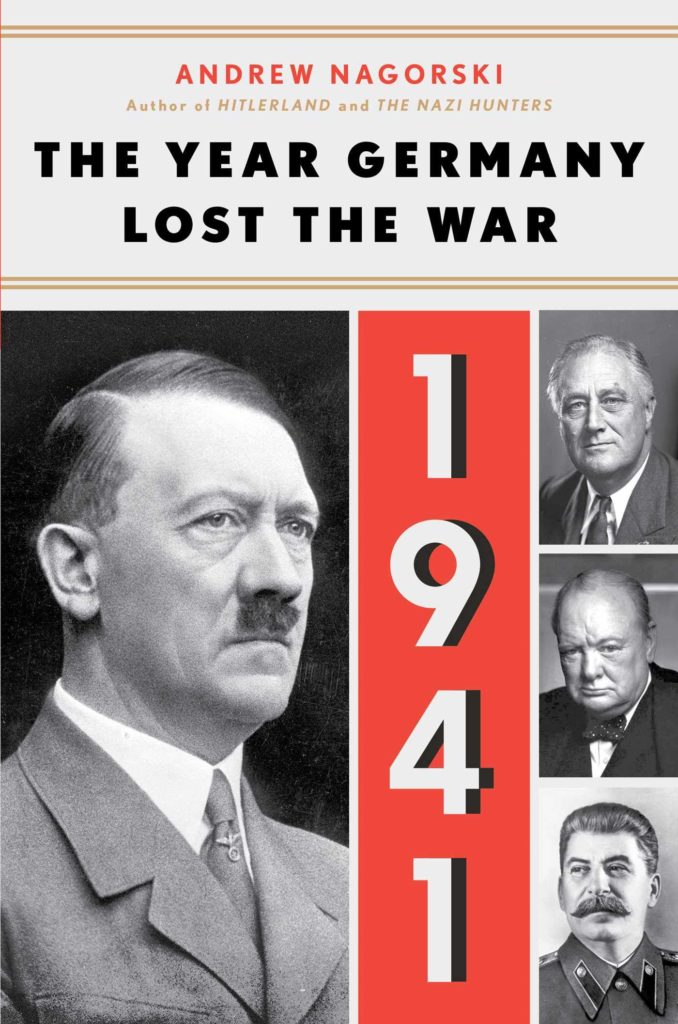
Pour en savoir plus sur cette année charnière que fut 1941, se reporter à l’ouvrage publié en juin 2019 par le journaliste et historien américain Andrew Nagorski, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et, en particulier, du front est : « 1941. The Year Germany Lost the War », éd. Simon & Schuste.
#hitler, #moscou, #secondeguerremondiale






Soyez le premier à commenter